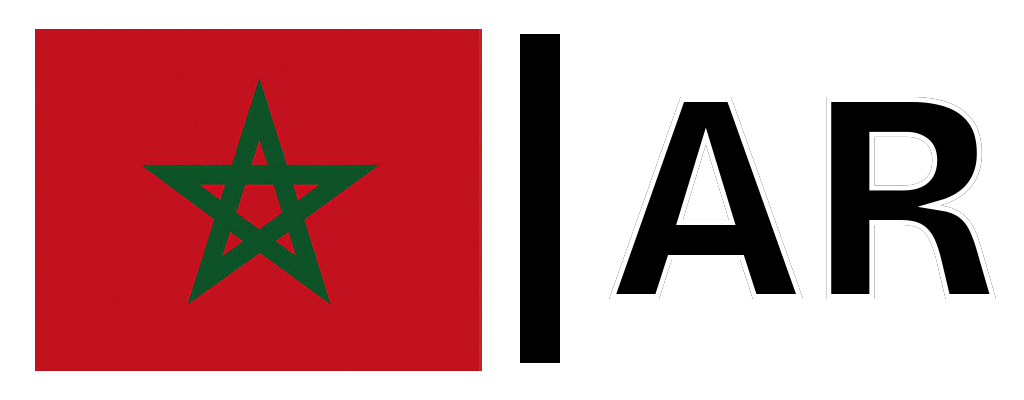- Introduction
-
Le Maroc, caractérisé par un climat méditerranéen, est désormais extrêmement vulnérable aux changements climatiques, qui se manifestent principalement par une augmentation des températures, une variation inter et intra-annuelle des précipitations, ainsi que par des sécheresses récurrentes. L’impact de ces changements du climat sur les rendements des cultures au Maroc, principalement les céréales, est de plus en plus important, avec une intensité légèrement accrue d’une année à l'autre.
D'un point de vue environnemental, les pratiques agricoles conventionnelles, notamment le travail du sol, ont causé une détérioration de la qualité du sol à travers l'intensification de l'érosion hydrique et éolienne ainsi qu'une réduction de la teneur en matière organique du sol. Ces pratiques pourraient aussi participer aux émissions de gaz à effet de serre qui sont à l'origine du réchauffement climatique.
Sur le plan économique, la production agricole fait face à une augmentation croissante des prix des intrants agricoles, principalement l’énergie. Ce qui implique l’augmentation des coûts de production des cultures.
Dans ce contexte, et pour faire face à ces défis, il est nécessaire de repenser la production agricole en s’orientant vers des systèmes résilients et durables qui visent non seulement une utilisation optimale des intrants et une stabilité des rendements, mais également une préservation des ressources en sol et en eau, et une atténuation du changement climatique.
Parmi les systèmes de production offrant une solution efficace et durable pour faire face aussi bien aux aléas du changement climatique qu’aux défis économiques et environnementaux susmentionnés, figure le système d’Agriculture de Conservation (AC).
L'Agriculture de Conservation, qui s'oppose à l'agriculture conventionnelle reposant sur le travail intensif des sols, représente une alternative pour remédier à la faible productivité agricole et à la dégradation des ressources naturelles telles que le sol et l'eau.
Selon la FAO (2022), l'agriculture de conservation est un système cultural qui favorise une perturbation minimale du sol (c'est-à-dire sans travail du sol ou semis direct), le maintien d'une couverture permanente du sol et la diversification des espèces végétales. Elle renforce la biodiversité et les processus biologiques naturels au-dessus et au-dessous de la surface du sol, ce qui contribue à accroître l'efficacité de l'utilisation de l'eau et des nutriments et à améliorer durablement la production végétale. L’agriculture de conservation est un concept qui soutient la gestion durable des terres, la protection de l’environnement et l’adaptation au changement climatique et son atténuation.
- Origines et Histoire du semis direct
-
La préservation des ressources n’est pas une idée récente. Le passage de l'agriculture conventionnelle axée sur le travail du sol à une autre forme d’agriculture a démarré dans les années 1930, suite au « Dust Bowl » qui a frappé les agriculteurs du Midwest des États-Unis, poussant ainsi la communauté scientifique à repenser les dysfonctionnements de l'agriculture, notamment en matière de conservation des sols (Kassam et al., 2022). La minimisation des perturbations des sols combinés au mulch de surface par les résidus des cultures fut constitué une avancée majeure dans la compréhension de la manière dont l'objectif d'intensification de la production agricole pouvait être combiné avec celui de conservation des sols et de l'eau par les agriculteurs. L’évolution de ce système et son adoption au niveau mondial ont connu un retard à cause de plusieurs facteurs limitants, à savoir la gestion des adventices et le développement des semoirs adaptés aux conditions des sols et du climat. Le véritable développement du système d’AC dans le monde a commencé à partir des années 1990 pour atteindre une superficie globale de 205 millions d’hectares en 2019, soit 14,7 % des terres mondiales cultivées (Kassam et al., 2022).
Au Maroc, Le système semis direct, l’un des principes fondamentaux de l’AC, a été introduit au début des années 80 dans le cadre d’un partenariat entre L’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) et L'Agence des Etats-Unis pour le Développement International (USAID) ayant pour objectif la création d’un Centre de Recherches en Aridoculture (Settat).
Les travaux de recherche menés par les chercheurs de l’INRA en zones semi-arides marocaines, ont montré l’importance de ce système, aussi bien pour la conservation et l’amélioration de la qualité des sols que pour l'atténuation des effets de la sécheresse dans ces zones. D’autres travaux de recherche furent ensuite menées dans d’autres zones agro-climatiques, à savoir le Zaer par l’Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II (IAV Hassan II) et le Saïs par l’Ecole Nationale d’agriculture (ENA de Meknès) de Meknès. Néanmoins, si les travaux de recherche sur le système semis direct ont débuté au début des années 80, l’extension de cette technologie à large échelle en milieu réel n’a débuté qu’à partir de l’année 2015 avec une accélération en 2020 avec le démarrage du Plan National de Semis Direct en 2021 qui ambitionne d’atteindre 1 Million d’hectares de ce système de production en 2030. En effet, les superficies de semis direct ont connu une croissance accélérée depuis cette date pour atteindre près de 118 000 ha lors de la campagne 2023-2024 (Ministère Agriculture, 2024).
- Principes de l'agriculture de conservation
-
Les trois principes de l’agriculture de conservation sont les suivants:

Une perturbation mécanique minimale des sols, Aucun travail du sol (Le semis direct).
Une couverture organique permanente du sol (d’au moins 30%) par des résidus végétaux et/ou de cultures de couverture.

Une diversification des espèces cultivées, obtenue en cultivant successivement plusieurs espèces (au moins trois) ou en les associant.
- Bienfaits agronomiques
-
Le système d’agriculture de conservation permet d'augmenter la capacité de stockage du sol en eau et l'amélioration des bilans hydriques des parcelles, et ce, à travers la réduction des pertes en eau par évaporation et l’amélioration de l’infiltration. D’autre part, ce système permet la réduction de la quantité de semences utilisée, ce qui implique une diminution de la concurrence entre les plantes, une augmentation de la tolérance des cultures au stress hydrique et une amélioration de l’efficience d’utilisation de l’eau en zones arides. Il permet aussi de réduire à moyen et long termes les apports de fertilisants, notamment azotés, avec l’augmentation de la teneur en matière organique du sol.
Le système d’agriculture de conservation permet également d'améliorer la fertilité et l'activité biologique du sol ainsi que sa structure grâce à l'augmentation du taux de la matière organique, ce qui implique une amélioration de la nutrition des plantes.
Grâces aux avantages précités, le système d’agriculture de conservation permet en conséquence une amélioration des rendements des cultures et de l’efficience d’utilisation de l’eau. - Bienfaits environnementaux
-
Le système d’agriculture de conservation permet de protéger le sol contre l'érosion hydrique et éolienne grâce à la couverture permanente du sol par les résidus de culture. L’agriculture de conservation contribue également à la séquestration du carbone dans le sol à travers l’amélioration du taux de la matière organique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à la diminution des intrants, notamment énergétiques. Elle contribue également à l'amélioration de la biodiversité du sol.
- Socio-économiques
-
Le système d’agriculture de conservation engendre plusieurs avantages socioéconomiques qui peuvent être résumés comme suit :
• Réduction des coûts d’installation des cultures suite à la suppression des opérations de travail du sol et de préparation du lit de semences.
• Réduction des coûts des semences de 30 à 35%.
• Amélioration des revenus et du bien-être des agriculteurs.
• Gain du temps suite à la suppression du travail du sol.
• Diminution de la charge du travail pour les agriculteurs.
• Diminution du coût de la main d’œuvre, notamment pour les grandes exploitations.
• Réduction de l’investissement en équipements agricoles de travail du sol.
• Augmentation de la durée de vie du tracteur.
- Semoir semis direct
-
La mécanisation reste le premier poste de charge des exploitations, les choix en matière d’agroéquipements et de stratégie de mécanisation ont donc un impact direct sur le revenu des agriculteurs, mais également sur leurs conditions de travail et leur capacité à valoriser de nouvelles techniques (ADA, 2016).
Le succès du système de semis direct réside, entre autres, dans la maitrise de l’opération du semis, et en particulier le choix du semoir adapté, son réglage et son utilisation adéquate. Contrairement aux semoirs utilisés dans le système conventionnel, qui sont adaptés aux semis sur des sols déjà travaillés et qui ne contiennent pas de résidus de culture, les semoirs de semis direct se distinguent par la capacité de mettre en place les graines et les engrais dans un sillon avec une perturbation minimale du sol et en présence des résidus de culture. Le semoir de semis direct doit également garantir un meilleur contrôle de la dose et de la profondeur de semis.
En fait, les principaux critères à prendre en considération lors de la réflexion pour l’acquisition d’un semoir de semis direct sont comme suit (Bourarach, 2018) :
• Capacité de pouvoir semer dans les conditions locales de travail (nature et état du sol, nature et état de la couverture organique du sol) ;
• Capacité de pouvoir semer les cultures envisagées (petits ou gros grains, doses minimales et maximales, type de distribution) ;
• Caractéristiques dimensionnelles (largeur de travail, interligne (fixe/réglable), capacité trémie d’engrais, capacité de trémie et semences).
• Adaptation du semoir à la puissance du tracteur disponible (poids du semoir).
Généralement, la connaissance des caractéristiques et des objectifs assignés à l’exploitation agricole, outre les besoins à satisfaire pour les atteindre (cultures, superficies, systèmes de production, types de sol, puissance des tracteurs et climat), est considérée comme étant la base primordiale du choix d’un semoir de semis direct.
Les principaux types de semoirs de semis direct les plus utilisés au Maroc sont les semoirs à socs et les semoirs à disques. Le tableau ci-dessous résume quelques avantages et inconvénients de chacun de ces deux types de semoirs.
- Principaux avantages et inconvénients des semoirs de semis direct à socs et à disques
-
Les semoirs de semis direct à socs sont les mieux adaptés aux conditions marocaines pendant la phase de transition du système conventionnel au système de semis direct sachant leur adaptation aux larges conditions du sol et de culture, leur facilité d’entretien et d’utilisation et leur coût relativement bas. Pour encourager l’adoption du système de semis direct, le Ministère de l’Agriculture a instauré un système incitatif pour l’acquisition des semoirs de semis direct.
Avantages
Inconvénients
Semoirs à socs
Utilisation sur tous les terrains
Semoir compact porté sur attelage
Meilleure pénétration du sol
Bonne aération du sol
Poids relativement léger
Besoin minimum d’entretien
Nécessite moins d’entretien
Mieux adaptés au semis en conditions humides
Coût relativement moins élevé
Perturbation excessive du sol
Irrégularité de la profondeur de semis
Difficulté de gestion des résidus abondants
Déplacement des résidus
Problèmes fréquents de bourrage
Remontée des pierres en surface
Favorise la levée des adventices
Nécessite une puissance de traction relativement élevée
Dessèchement accentué de la zone semée
Semoirs à disques
Perturbation minimale du sol
Semoir mieux adapté aux conditions de forte présence de résidus
Résidus peu déplacés
Interlignes plus étroites
Dessèchement moindre de la zone semée
Emplacement régulier de la semence et de l’engrais dans le sol
Nécessite une plus faible puissance de traction
Poids relativement plus élevé
Capacité de pénétration insuffisante
Entretien fréquent des pièces roulantes
Fermeture non convenable des sillons dans le cas des sols lourds
Semoir inadapté aux terrains caillouteux
Non adapté au semis en conditions humides
Coût relativement plus élevé
- Introduction
-
Face à l’accentuation des effets du changement climatique et à la raréfaction des précipitations, il devient impératif d’explorer et de déployer à grande échelle des modèles territoriaux de transition agroécologique, intégrant des leviers d’adaptation diversifiés et complémentaires. C’est dans cette perspective que le programme Al Moutmir a été lancé en 2019, en partenariat avec le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts et l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), avec l’appui scientifique de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P).
Le programme Al Moutmir vient ainsi soutenir le Plan National de Semis Direct, qui ambitionne d’atteindre un million d’hectares à l’horizon 2030, tout en accélérant l’adoption des pratiques d’agriculture de conservation pour renforcer la résilience des systèmes agricoles marocains face aux effets du changement climatique.
Pour la campagne agricole 2023-2024, le programme a couvert 32 710 hectares en semis direct à travers 125 communes territoriales réparties sur 23 provinces, avec l’implication de plus de 4 300 agriculteurs bénéficiaires et le déploiement de 68 semoirs au profit de 70 organisations professionnelles partenaires. Les superficies réalisées en semis direct concernent : les céréales (92%), les légumineuses (4%), les cultures oléagineuses (3%) et les cultures fourragères (1%).
Cette dynamique est portée par une équipe jeune et engagée d’agronomes de terrain, dont le rôle est central dans l’accompagnement, la mobilisation des parties prenantes et la co-construction d’un écosystème d’innovation inclusif. Pour répondre à ses ambitions, le programme s’appuie sur un plan d’action intégré, mis en œuvre en étroite coordination avec l’ensemble des parties prenantes institutionnelles, scientifiques et professionnelles.


Installation de la plateforme de démonstration de semis direct dans la province de Khouribga
Pour atteindre ses attentes, le programme Al Moutmir a déployé un plan d’action intégré en collaboration avec les différents partenaires, institutionnels et autres.
Actions Objectifs Sélection et sensibilisation des OP porteuses et des agriculteurs. Encourager l’adoption des bonnes pratiques de l’agriculture de conservation : semis direct, gestion des résidus et diversification des cultures Formation des membres et tractoristes des OP sur le réglage, l'utilisation et la maintenance des semoirs Renforcer les capacités des membres et tractoristes des OP en matière de réglage, d’utilisation et de maintenance des semoirs Acquisition et mise à disposition de nouveaux semoirs au profit des OP partenaires Répondre à la demande croissante en équipements et accompagner l’expansion du programme Suivi technique et accompagnement des agriculteurs par les agronomes provinciaux Appuyer la bonne conduite des plateformes de démonstration (PFD) et assurer un transfert de technologies sur le terrain Organisation de démonstrations et d'écoles au champ autour des PFD de semis direct Valoriser les résultats obtenus et susciter l’adhésion des communautés agricoles environnantes Identification de zones à fort potentiel et de nouvelle OP actives. Etendre le périmètre d'intervention à d'autres zones favorables Participation à des journées de sensibilisation en partenariat avec les acteurs du secteur Mobiliser et fédérer les partenaires autour de la dynamique du semis direct Installation, suivi et analyse des résultats des Plateformes de Démonstration Générer des données technico-économiques fiables pour évaluer les performances du système Élaboration de rapports techniques et des publications scientifiques Valoriser les résultats des plateformes de démonstration, assurer le partage des connaissances et capitaliser les acquis générés. Produire et diffuser des contenus pédagogiques et multimédia à destination de divers publics : capsules vidéo, brochures, émissions radio, etc Promouvoir et vulgariser les principes et bénéfices du semis direct auprès d’un large public Organisation de webinaires techniques et d’un Open Innovation Lab en fin de campagne Partager les résultats, évaluer les acquis et identifier les leviers d’amélioration et de montée en échelle Organisation d’une communauté de pratique (CoP) sur l’agriculture de conservation Structurer un espace d’échange, de partage de connaissances et de coordination entre acteurs engagés dans la transition vers le système d’agriculture de conservation
- Les plateformes de démonstration : Voir c'est croire!
-
Dans une logique de démonstration agronomique participative, le programme Al Moutmir de semis direct a mis en place plus de 584 plateformes de démonstration (PFD) sur l’ensemble des zones couvertes, afin de comparer objectivement le système de semis direct au système conventionnel. Ces plateformes ont été installées dans différentes zones agro-climatiques, en adoptant des Integrated Crop Programs (ICP) tenant compte des recommandations scientifiques et des spécificités agro-écologiques locales.
L’itinéraire technique mis en œuvre pour les cultures céréalières repose sur une approche de gestion intégrée visant à :
a) optimiser l’utilisation de l’eau et des intrants,
b) mettre en œuvre une lutte intégrée contre les adventices, maladies et ravageurs,
c) réduire les coûts de production,
d) renforcer la durabilité des systèmes de culture,
e) atténuer les impacts environnementaux négatifs (sols, eau, air, biodiversité).
La campagne agricole 2023-2024 s’est déroulée dans un contexte climatique particulièrement contraignant, marqué par une pluviométrie largement déficitaire jusqu’au mois de mars. Les parcelles gérées en semis direct, avec un apport raisonné en engrais de fond, ont mieux résisté au stress hydrique de mi-cycle. La reprise des précipitations en mars (plus de 80 mm au niveau national) a favorisé une relance significative de la croissance des cultures, notamment celles conduites en semis direct, qui ont pu atteindre le stade de remplissage des grains.
Dans l’ensemble des zones agro-climatiques, le semis direct a démontré des performances supérieures, tant en biomasse qu’en production de grains, malgré la réduction de la durée du cycle et le déficit pluviométrique. La combinaison entre les bonnes pratiques agricoles (via les ICP) et l’adoption du semis direct a permis de sécuriser la production céréalière dans de nombreuses régions.
Sur le plan économique, le semis direct a permis une réduction des charges d’exploitation allant de 900 à 1 400 MAD/ha, grâce à l’élimination des travaux de préparation du sol et à la baisse des doses de semis. Ce gain initial offre aux agriculteurs une capacité d’investissement supplémentaire pour l’achat des intrants ou la diversification de leurs activités.
Sur le plan technique, les résultats observés à l’échelle nationale ont montré que les rendements biologiques des PFD en semis direct ont enregistré une augmentation moyenne de +21,5 % par rapport aux témoins locaux en système conventionnel. Quant au rendement grain, le gain moyen a atteint +11,2 %, confirmant l’efficience agronomique de ce système innovant dans les conditions agro-climatiques marocaines.
Dispositif expérimental des plateformes de démonstrations, semis direct vs semis conventionnel
Les travaux de recherche menés à l’échelle nationale et internationale confirment que le semis direct constitue l’un des piliers fondamentaux de l’agriculture de conservation. Les résultats obtenus à travers les plateformes de démonstration du programme Al Moutmir sont particulièrement prometteurs et devraient inciter l’ensemble des acteurs du secteur agricole – publics comme privés – à renforcer, coordonner et mutualiser leurs efforts en vue d’accélérer la diffusion de ce système à l’échelle nationale.
L’expérience du programme Al Moutmir démontre qu’un accès structuré aux équipements, notamment les semoirs, combiné à une approche participative mobilisant les organisations professionnelles locales, constitue un levier efficace pour élargir les superficies ensemencées selon ce mode. Le ciblage des zones à fort potentiel, associé à un accompagnement de proximité et de qualité, s’avère également déterminant pour ancrer durablement les pratiques et garantir leur adoption à long terme.
- Potentiel de séquestration du carbone en semis direct au Maroc : Cas d’étude du programme Al Moutmir de semis direct
-
Cette étude, réalisée en collaboration avec le Centre d’Innovation Agricole et de Transfert de Technologie (AITTC-UM6P), évalue le potentiel de séquestration du carbone associé à la culture du blé en semis direct dans 25 provinces marocaines, en mobilisant la méthodologie du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Conduite dans le cadre du programme Al Moutmir de semis direct, cette analyse s’appuie sur une superficie totale de plus de 24 000 hectares pour la campagne agricole 2022-2023, en intégrant des sources de données multiples afin de modéliser la dynamique du carbone organique des sols et d’estimer l’évolution des stocks de carbone dans le temps.
Les résultats mettent en évidence un potentiel significatif de séquestration de carbone dans les systèmes en semis direct, reposant sur l’accumulation dans les réservoirs de carbone actif, lent et passif. Ce potentiel varie sensiblement selon les provinces, en fonction des caractéristiques pédoclimatiques locales. Les zones montagneuses et humides, moins exposées aux fortes chaleurs, affichent les valeurs les plus élevées, atteignant respectivement 0,96 t C/ha et 1,40 t C/ha. À l’inverse, les zones intermédiaires et défavorables, soumises à un déficit hydrique et à des températures plus élevées, présentent des potentiels plus faibles, de l’ordre de 0,63 t C/ha et 0,86 t C/ha.
L’incorporation des résidus de culture dans le sol s’avère déterminante pour améliorer la séquestration du carbone. Cette pratique favorise la formation d’humus, le stockage du carbone, la structuration du sol, la rétention en eau et l’activité microbienne, tout en limitant l’érosion des nutriments et en contribuant à l’amélioration des rendements agricoles à long terme. À titre illustratif, dans la province de Meknès — zone à fort potentiel pour l’agriculture de conservation — l’intégration de 10 % de résidus de culture permet d’atteindre un potentiel de séquestration de 7,41 t C/ha, tandis qu’un taux de 50 % élève ce potentiel à 27,35 t C/ha. Cet effet est d’autant plus marqué dans les sols à faible teneur en sable, soulignant l’importance des fractions argileuses et limoneuses dans le stockage du carbone.
Cette recherche met en lumière la complexité des mécanismes de séquestration du carbone en contexte agricole, soulignant la nécessité d’approches contextualisées, tenant compte des spécificités pédoclimatiques et des pratiques de gestion des résidus. Le semis direct du blé présente ainsi un fort potentiel d’atténuation climatique, à condition d’être intégré dans une stratégie globale et adaptée.